 Un havre de paix
Un havre de paix
J’aimerais, si vous le permettez, accaparer quelques instants votre attention, vous arracher aux parfums capiteux du quotidien.
J’ai longtemps jugé, longtemps considéré les autres d’un air supérieur, persuadé à tort d’être un être à part, doté d’une intelligence rare et d’une volonté infaillible. Mais mon histoire n’a rien d’exceptionnelle, pire, elle m’apparaît aujourd’hui d’une affligeante banalité au regard de celles de bon nombre d’entre nous.
Le texte suivant retrace selon mes souvenirs les détails de mon séjour au « Clos ». Une expérience douloureuse, inspirante, étrange, vécue il y a plusieurs années. Une période charnière de mon existence.
Mon premier contact avec le « Clos » fut l’objet d’un pur concours de circonstances. D’une défaillance, plutôt.
Début septembre 2014, plusieurs de mes collègues et moi-même avions été conviés à un stage d’une semaine sur Toulouse. Cadeau de la direction au retour des vacances d’été. Il était convenu que nous logerions à compter du dimanche soir dans un hôtel situé près du centre-ville, une enseigne proposant couchage et restauration au meilleur prix. Selon mon habitude, j’avais veillé à me présenter à l’accueil le plus tard possible, d’une part car cela écourtait mon séjour de quelques heures, mais aussi parce que je n’avais aucune envie de partager un pot au comptoir du coin avec le reste de l’équipe. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque la réceptionniste m’informa qu’aucune réservation à mon nom n’apparaissait sur son registre. Je l’invitais à vérifier de nouveau. Elle ajouta d’un sourire gêné qu’elle ne disposait plus d’aucune chambre. Je tirais alors de ma poche une cigarette et dégainais mon téléphone.
L’entreprise m’accusa avec humeur de m’être trompé d’hôtel, et je dus par deux fois répéter l’adresse à la secrétaire d’astreinte avant que celle-ci n’admette qu’une erreur avait peut-être été commise. Je raccrochais puis piétinais longtemps à l’extérieur, éclairé par le halo des lumières tamisées du hall d’entrée. La nuit tombait à mesure que redoublait mon impatience. Quelques cigarettes plus tard, on m’annonça qu’aucun établissement convenable ne pouvait m’accueillir avant plusieurs jours. La secrétaire me demanda si séjourner en chambre d’hôtes me posait le moindre problème. De toute ma vie, jamais je n’avais logé chez l’habitant, l’idée même de pénétrer l’intimité d’un autre me répugnait. J’acceptais pourtant, conscient que toute lutte se révélerait inutile. Au moment d’entrer les coordonnées sur mon GPS, je m’indignais devant le temps de trajet estimé. Trop tard, elle avait déjà raccroché. Je me souviens avoir maudit cette pauvre femme sur plusieurs générations.
Lorsque les phares de ma voiture découvrirent le panneau du petit village de Sainte-Cécile-du-Cayrou, je poussais une exclamation exagérée. Durant une heure, j’avais roulé pied au plancher, coupant virages et feux de circulation, jurant à m’en érailler la voix. La perte soudaine du signal GPS m’avait plongé dans une rage folle.
D’immenses plantations recouvraient la campagne profonde. Des cépages bordaient les routes, accompagnés çà et là de bosquets d’arbres touffus. De vieux poteaux électriques bornaient la voie, tel un fil d’Ariane laissé à destination des voyageurs égarés. Mais pas une âme qui vive.
Hormis quelques rares corps de ferme éclairés, il ne semblait subsister aucune trace de civilisation.
J’aperçus bientôt le sommet d’un clocher et, considérant mon errance terminée, soulignait l’événement d’un soupir de soulagement. Grossière erreur. Les gens de coin avaient de toute évidence le sens de l’humour. Ils avaient construit leur église au milieu de nulle part, sans rien ni personne aux alentours. Sans doute devaient-ils s’y rendre en tracteur, ou à vélo. À environ deux kilomètres, je repérais enfin la mairie, une haute bâtisse en pierre, signalée par deux réverbères incandescents. J’avisais la silhouette d’un homme rondelet en plein chargement d’un SUV et décidais de lui demander mon chemin. Je relevais sur son visage une gêne à peine voilée à l’évocation de ma destination. Il ne m’en indiqua pas moins l’itinéraire à suivre.
Après un second passage près de l’église, je poussais vers le nord, puis gagnais la lisière d’une forêt dense et vallonnée. La route s’enfonçait dans le secret des bois. La chaussée se rétrécissait à vue d’œil. La végétation me coupait toute visibilité, si bien que je me résignais à ralentir, de peur de surprendre la traversée d’animaux sauvages. Au sortir de ce qui me sembla un virage à angle droit, j’atteignis un premier croisement. Sur les conseils de l’homme au SUV, je quittais l’asphalte au profit d’un sentier. La vue d’une imposante masse grise vint conclure mon épopée, un immense mur d’enceinte dressé en pleine forêt, surmonté d’une rangée de lanternes lumineuses. Je tournais à gauche, remontais la piste jusqu’à rencontrer un grand portail en fer forgé.
Deux blocs de pierres brutes ceignaient la structure principale. Sur le mur, une croix à huit branches dont l’origine m’était inconnue. Un cartouche taillé renseignait en lettre capitale le nom du domaine :
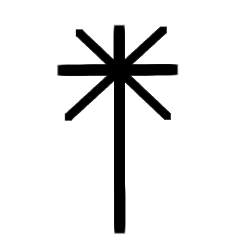
J’arrêtais la voiture. Je sortais, longeais l’enceinte à la recherche d’un interphone, d’une cloche. Le portail était resté grand ouvert. Un nouveau jeu de lumière flamboyant balisait une étroite allée de gravier.
Je risquais un coup d’œil à l’intérieur, avançais d’un pas ou deux, plissais les paupières. Personne.
Je me réinstallais au volant, consultais en vitesse les avis sur internet. Deux étoiles à peine. Une foule de commentaires incendiaires. Merveilleux. Je parcourais le journal d’appels, songeais un instant à sermonner la secrétaire, avant de jeter mon téléphone sur le rembourrage du siège passager. J’avais envie d’une cigarette.
Passé le portail d’entrée, un vaste terrain boisé se dessinait. Je poussais jusqu’à ce qui me sembla une aire de repos destinée à la clientèle, garais ma voiture, puis déchargeais une à une mes valises. Un jardin précédait un vieux corps de ferme décrépit à la façade recouverte d’un lierre épais. Partout brillait l’éclat des lanternes, et je crus apercevoir au loin les flammes du mur d’enceinte.
À présent, j’abordais les lieux avec une certaine retenue. La propriété, baignée de lumières vives, m’apparaissait comme une sorte d’invitation, et les fenêtres éclairées du foyer renseignaient de la présence des occupants. Personne, toutefois, ne venait à ma rencontre.
Mes valises à bout de bras, je m’engageais sur un petit chemin empierré lorsque j’entendis bouger tout près. Une silhouette blanche, bougeoir en main, filait d’un air décidé à travers le jardin, et j’eus tôt fait de l’interpeller de vive voix. Aujourd’hui encore, je ne sais si mes appels ont réellement porté jusqu’à lui, ou s’il avait jugé bon de les ignorer, trop accaparé par sa mission. Quoi qu’il en soit, la silhouette poursuivit sa route sans réagir, et je me souviens avoir levé les bras au ciel en signe de frustration. « Qu’est-ce que tu fabriques ? » me souffla alors à l’oreille une voix à l’accent prononcé.
Je sursautais, confondu, honteux. Je me retournais et faisais face à un vieil homme à la calvitie naissante, aux traits sévères et aux sourcils épais, tirant légèrement sur le gris. Un physique de comptable tel que j’aimais à les appeler à l’époque, à ceci près qu’il portait une djellaba brodée et une paire de mocassins. Il me toisa de derrière les verres de ses lunettes rondes, confirma mon identité puis déclara de but en blanc que j’avais l’air « d’un mort qui marche », une façon comme une autre de me souhaiter la bienvenue, j’imagine.
J’esquissais un sourire gêné, lorgnais de nouveau en direction du jardin. Lorsque je lui demandais qui était la personne à la bougie, il m’arracha mes valises d’un geste sec et m’invita à le suivre.
Sur le palier, il m’ordonna de retirer mes chaussures, puis me proposa une paire de pantoufles. « Politique de la maison », crut-il bon d’ajouter, comme s’il s’agissait d’une justification en soi. Une croix semblable à celle du portail d’entrée était fixée sur la porte. Déchaussé à son tour, mon hôte déposa ses mocassins dans le vestibule, puis gravit sans un mot un escalier en bois massif. « Tu occuperas la seconde chambre », trancha-t-il, en pleine ascension. Il déclara que ma réservation s’étendait sur une semaine complète, enchaîna sur un certain nombre de consignes strictes. J’approuvais sans broncher. Après une demi-journée sur les routes, mon esprit fonctionnait au ralenti. J’avais mal au dos et aux articulations. Je souffrais d’une migraine atroce depuis mon départ de l’hôtel J’étais trop fatigué pour réfléchir, encore moins écouter palabrer qui que ce soit. Comme le vieil homme me présentait mon couchage, je lui réclamais une aspirine. Il refusa sans une once d’hésitation.
« Tu n’as pas besoin d’une aspirine, simplement de repos », asséna-t-il, avant de me souhaiter bonne nuit. J’étais sur le point de répondre lorsqu’il tourna les talons, puis referma la porte derrière lui. Je n’avais plus la force de le poursuivre.
Je programmais un réveil sur mon téléphone, me penchais à la fenêtre puis savourais une cigarette bien méritée. J’eus beaucoup de mal à m’endormir. Je n’arrêtais pas de penser à la hauteur des murs, à voir courir la silhouette du jardin sous le clair de lune, et cette étrange croix à huit branches trônant jusque sur la porte d’entrée. Étais-je tombé dans une sorte de monastère ? Une abbaye ouverte au public ? Je songeais aux retours désastreux sur le site de réservation, me remémorais le tact de mon hôte. Les commentaires pointaient en effet le comportement du propriétaire. L’entreprise n’avait pas dû investiguer bien loin avant de porter son choix sur cet endroit, et mon esprit rejouait sans cesse la réaction du type de la mairie. Si même les honnêtes gens du pays se méfiaient, il y avait de quoi nourrir la suspicion…
Lundi matin, à la première heure du jour, je dévalais quatre par quatre les marches du grand escalier, bien décidé à plier bagage en vitesse. Hélas, le vieil homme m’attendait près du salon, à croire qu’il avait guetté toute la nuit. Il s’avança à ma rencontre, renifla.
— Tabac froid, déclara-t-il du ton du jugement rendu.
— Une sale habitude des fumeurs.
— Tu peux fumer, mais pas ici. Tu as accepté les règles, hier au soir.
— C’est vrai.
Les sacro-saintes règles de la maison. Il fallait retirer ses chaussures en rentrant, c’est tout ce dont je me souvenais. Mais j’avais donné mon accord, je ne pouvais pas prétendre le contraire.
— Tu as dormi ?
— Comme une pierre, je vous remercie.
— Tu vois. L’aspirine était bien superflue.
Il me proposa de me conduire à la table du déjeuner. Je refusais, arguant que je devais partir au plus tôt. Si ma réponse ne le convainc pas, il n’en laissa rien paraître et ne prit pas la peine de me questionner quant à la présence de mes valises. À la place, il souhaita savoir si je reviendrais pour midi et me recommanda plusieurs adresses que je m’empressais d’oublier. Une fois dehors, je me pressais en direction de ma voiture. Le vieil homme me talonnait sans un mot, d’un pas tranquille, mais vif. Il était encore en bonne forme malgré son âge.
Sous les rayons du soleil automnal, la forêt commençait à revêtir des teintes orangées. J’aperçus au loin les deux pans du portail franchi la veille. Le domaine était immense. L’allée de gravier s’allongeait sur au moins cinq cents mètres. Le jardin était aménagé avec soin. En pur profane, je reconnaissais plusieurs plants de lavande, de sauge, de laurier. Des rosiers fleuris apportaient une touche de couleur vive. Une fontaine à eau ponctuait de son doux murmure le pépiement des oiseaux. L’accès était délimité par deux arches végétales. Au-delà de l’aire de stationnement, près du garage, se trouvait un vaste potager comparable à celui d’un maraîcher, et l’on devinait le début d’un verger derrière la maison. Sur le toit de la bâtisse principale, un ouvrier travaillait à l’installation de panneaux solaires, fredonnant un chant du pays. Était-il possible qu’on m’ait accordé un genre de compensation, finalement ? C’était peu probable si l’on s’en tenait à la politique de l’entreprise. Le doute persistait toutefois au regard de ce que j’avais sous les yeux.
Le vieil homme m’avait rattrapé. Je profitais de sa présence pour l’interroger sur ses prix. Il se contenta de répondre que les tarifs pratiqués par la maison étaient tout à fait corrects en ce qui concernait les égarés.
— Bon. Qu’est-ce que vous voulez, encore ? Je suis pressé, soufflais-je. Ses petites répliques cinglantes commençaient à m’agacer.
— Déjà que tu fumes malgré l’interdiction. Tu ne comptes tout de même pas partir avant d’avoir salué le propriétaire ?
— Attendez, mais ce n’est pas vous, le propriétaire ?
Pour toute réponse, il rassembla ses mains en cornet, interpella l’ouvrier. Un certain Amir. Celui-ci se redressa malgré la hauteur, et je remarquais qu’il n’utilisait pas le moindre dispositif de sécurité.
Il se laissa glisser le long du toit, enjamba la gouttière, puis descendit les étages d’un petit échafaudage. Une fois rendu au sol, il retira ses gants, s’épongea le visage à l’aide d’un mouchoir tiré de son bleu de travail. Il présentait les traits d’un cinquantenaire à la carrure svelte et sportive. De longs cheveux bruns auréolaient son visage. Un léger bouc terminait la pointe de son menton. Je crus reconnaître à sa démarche enfiévrée la silhouette du jardin, hypothèse dont j’obtins plus tard la confirmation.
Nous échangeâmes une rapide poignée de main, et j’éprouvais un réel malaise au contact de ses doigts noueux. Par pure politesse, je tentais d’engager la conversation, mais sans résultat. Il me gratifia de son plus beau sourire, me dévisagea de ses yeux en amande. Je fus frappé par la fixité de son regard. Lorsque je retirais ma main, il s’inclina en signe de salut, puis s’en retourna à son travail. Il regagna le sommet de son échafaudage et moi le siège de ma voiture.
— Le portail sera fermé à 21h00, ajouta le vieil homme, de sa morgue habituelle. Nous t’attendrons pour dîner.
J’acquiesçais sans conviction, claquais la portière. « C’est ça, oui », prononçais-je tout bas, tournant la clef de contact.
Je me présentais quelques minutes avant le début de la formation et fumais la première cigarette de la journée en présence de mes collègues. Les plaisanteries allaient bon train au sujet de mon relogement.
Selon la formule consacrée, nous inscrivîmes nos prénoms sur de petits cartons pliés. Les bureaux étaient disposés en cercle, de façon à ce que nul ne soit tenu à l’écart du reste du groupe. Le formateur, un jeune blanc-bec aux oreilles décollées, projeta contre le mur le plan de formation, chercha à créer un faux sentiment de complicité d’entrée de jeu. Durant cette semaine, il nous aiderait à la prise en main du logiciel. La journée de vendredi serait consacrée à l’examen.
« Rien de bien méchant, vous en faites pas. On fera les corrections ensemble. Et s’il vous manque des points, on pourra toujours s’arranger. Avec moi, on ne laisse personne sur le carreau. »
C’est une lubie de notre temps de feinter l’amitié en toute circonstance. Votre banquier, votre assureur, votre patron, tout ce beau monde se présente par leur prénom et vous invite à en faire de même. « Allons, pas de chichi entre nous. » L’équivalent d’une bonne tape dans le dos. Le tutoiement et la familiarité sont devenus des normes enseignées à tous les poussins en école de commerce. À l’époque, déjà, j’exécrais cette tendance. Dès les premiers échanges, elle me laissait un arrière-goût acide en bouche. Elle me vrillait les oreilles. Aussi, je me pris d’emblée à détester cordialement ce pauvre garçon.
Les présentations terminées, nous attaquâmes les choses sérieuses. Je retirais de ma sacoche mon ordinateur portable et branchais mon chargeur sur la multiprise disposée à nos pieds. On nous distribua un polycopié sur lequel figuraient l’identifiant et le mot de passe de la borne Wi-Fi. Un lien de téléchargement privé pointant sur le site du constructeur nous permit de lancer l’installation. Le formateur vantait les mérites de l’équipe de développement et des valeurs défendues par la firme. Il embraya sur la promesse d’un gain important de productivité. Je gagnais ma vie comme prestataire pour le compte d’une grande entreprise française. Mon boulot consistait à orchestrer le travail des autres, à les pousser à tout donner pour des gens qui connaissaient à peine leur nom. Vous ne voyez pas ? Mais si, vous en côtoyez forcément. Toujours le sourire aux lèvres, un enthousiasme débordant chevillé au corps. Une touche de « bienveillance » rabâchée sur tous les tons. Manager ! Voilà, vous avez trouvé. Le cours concernait le dernier-né des laboratoires du pays de l’oncle Sam, le nec plus ultra en matière de gestion de personnel. « Support, performance and optimization ». Pourquoi s’embarrasser d’un vieux concept poussiéreux comme la confiance lorsque vous pouvez coller un mouchard à tout le monde, chronométrer leurs faits et gestes et les leurs renvoyer à la figure à la prochaine réunion ? Adossé contre le dossier de ma chaise, une main sous le menton, l’autre occupée à pianoter sur mon ordinateur, je singeais l’attitude du parfait salarié, mon attention fixée sur le décompte de l’horloge numérique. J’avais hâte de partir, de boucler cette semaine pourrie et de rentrer chez moi.
Je regagnais le « Clos » pour vingt heures sous les prémices d’une splendide nuit d’été. Le vieil homme m’attendait dans l’entrée. Il exigea que je retire mes chaussures avant même mon arrivée. Une fois à l’intérieur, il m’invita à rejoindre la table du dîner, arguant qu’au train où allaient les choses, les plats allaient finir par refroidir. Quel plaisir ce fut de lui annoncer d’un air chagrin que j’avais déjà mangé.
J’avais mal digéré la façon dont il s’était adressé à moi depuis le départ, pire, j’enrageais devant l’inconséquence de mon employeur. En début de matinée et durant presque toute la pause déjeuner, j’avais rendu compte au téléphone de l’excentricité de mes hôtes, de l’isolement de la propriété, des réticences visibles des locaux, j’avais grossi le trait jusqu’à la caricature dans l’espoir d’obtenir un nouveau logement. Pourtant mes appels étaient restés lettre morte.
J’empruntais le grand escalier en bois massif. Je retrouvais ma chambre, déposais mes valises et m’installais au bord du lit, la mine défaite. D’une taille modeste, la pièce n’en était pas moins décorée de plusieurs tableaux, de plantes vertes et de petites statuettes tribales. Le lit double, couvert d’un drap rouge vif, surplombé d’une énième croix à huit branches, occupait à lui seul un tiers de l’espace. Aucun poste de télévision ni de radio. Face au lit, près de l’unique fenêtre, se trouvait un bureau sur lequel reposait une antique machine à écrire ainsi qu’une pile de papier vierge. Je poursuivais mon exploration, et découvrais après un passage devant la coiffeuse une fabuleuse cabine de douche en pierre. Aucune cloison ne séparait le tout du reste de la chambre. Sous la pomme de douche, je remarquais la présence d’un dispositif de massage. J’hésitais l’espace d’un instant puis, prenant conscience de mon odeur corporelle, me jetais sur ma valise et en tirais une serviette propre. Le sifflement des jets à haute pression avait quelque chose d’hypnotique. La sensation sur ma peau était si agréable que je prolongeais la session aussi longtemps que possible. Après tout, ce n’était pas à moi de payer la facture.
Je sortais de la cabine détendu comme jamais puis me séchais les cheveux. Je me décidais enfin à me mettre au travail et remplaçais la machine à écrire par la masse sombre de mon ordinateur portable.
Malgré la formation, les courriers continuaient à s’entasser sur ma boîte mail. J’intervenais dans le cadre d’un transfert d’activité et conduisais à distance les derniers licenciements. Ainsi m’attendaient en ligne les retranscriptions de telle ou telle réunion, les rapports quotidiens, les entretiens par visio, les chiffres et les prévisions de grèves à venir. Sans oublier mes propres comptes rendus.
Ce soir-là pourtant, alors que j’allumais mon ordinateur et déroulais le fil d’alimentation, je constatais de l’absence de prise de courant sous mes pieds. Perplexe, je parcourais toute la surface de la chambre, observais les cloisons, remontais le cône de la cabine de douche. J’allais même jusqu’à déplacer les meubles. Je ne comprenais pas. Des appliques murales fournissaient une lumière artificielle. Les interrupteurs fonctionnaient. La pièce était bien alimentée en électricité. J’entrepris d’interroger les propriétaires. Occupé à compulser ses registres à son bureau, le vieil homme m’accueillit de sa mine ordinaire et ne parut pas le plus surpris du monde lorsque je lui présentais mon problème.
Il me confirma d’un air brut que l’absence de prises de courant était on ne peut plus normale, car ils ne disposaient que de la charge hebdomadaire des seuls panneaux solaires installés sur le toit. L’énergie ainsi stockée permettait le bon fonctionnement de l’éclairage, du four, du frigidaire et du ballon d’eau chaude.
— Comment faites-vous pour la lessive, l’aspirateur, la vaisselle ?
— Mais le plus simplement du monde.
— Je dois travailler, j’ai besoin de mon ordinateur.
— Du travail, à cette heure-ci… souffla le vieil homme d’une moue affligée. « Ils te payent les heures supplémentaires, j’espère. »
Ils ne les payaient pas.
Je regagnais ma chambre, claquais la porte et me retranchais derrière l’écran de mon ordinateur. Je constatais que ni lui ni mon téléphone ne captaient le moindre réseau. Je serrais les phalanges, respirais par bouffées rapides. J’imaginais déjà s’entasser les bulletins d’informations, les réclamations du client, les avertissements. J’étais forcé de rattraper mon retard en journée, durant la pause café ou le temps du midi. Et tout ça pour quoi ? Une bande d’illuminés, un vieil avare et son complice emmurés en pleine forêt. Qu’ils s’isolent du reste du monde si ça leur chante, mais qu’ils laissent en paix les braves gens, pensais-je. Quelle idée d’ouvrir une maison d’hôte lorsque l’on se refusait à la plus élémentaire modernité.
Je rabattais l’écran de mon ordinateur et, penché à la fenêtre, prêt à enflammer une cigarette, entrepris d’aller me dégourdir les jambes. Une petite balade nocturne me ferait le plus grand bien. Et puis, personne ne pourrait me reprocher de fumer dehors.
Le vieil homme ne m’en interpella pas moins sur le seuil et me prévint de la présence d’animaux sauvages en cette période de l’année. Je ne tins pas compte de ses avertissements.
Une douce brise soufflait à l’extérieur. Je descendis le chemin empierré, franchis l’arche végétale. Les lanternes disséminées un peu partout permettaient de se repérer sans effort, celles alignées au sommet du mur d’enceinte détouraient sur fond noir les contours du domaine. Je jetais un rapide coup d’œil en direction de la maison, me déportais d’une dizaine de mètres environ. Une lumière dansait à l’autre bout du jardin. Sans doute celle d’Amir, estimais-je malgré la distance. Je l’avais déjà observé en pareille posture le jour de mon arrivée, et me demandais ce qu’il pouvait fabriquer dehors en pleine nuit.
J’allumais avec précaution une cigarette, remontais l’allée principale. Je poussais mon exploration jusqu’au portail d’entrée. Celui-ci était fermé par une lourde chaîne, et je me souviens avoir forcé sur ses anneaux à m’en faire blanchir les jointures.
C’était une réaction puérile, irréfléchie, et je me reprochais aussitôt ma conduite. Que je le veuille ou non, j’étais piégé ici, perdu au milieu de cette nature sauvage. J’étais livré à moi-même.
Sur le retour, je me pris à contempler le ciel. Pas le moindre nuage à l’horizon. Les étoiles brillaient en une fine pluie sans fin maintenue en suspension. Loin du dédale des villes, de la pollution lumineuse, la voûte céleste révélait ce soir-là tous ses secrets. Un frémissement me tira alors de mon examen, se répéta une ou deux fois, puis disparut tout à fait. Figé sur place, je regardais par-dessus mon épaule, sillonnais les environs. L’avertissement de mon hôte me revint en mémoire. Je songeais qu’il pourrait s’agir d’un sanglier. Ou de tout autre chose. Mon cœur battait la chamade. Au bout du chemin, la maison brillait tel un phare dans la nuit, le lierre épais dévorant sa façade. J’avais la sensation d’être observé, à la merci de quelques prédateurs invisibles. Un nouveau son suffit à me décider à rentrer, et je franchissais en nages le seuil de la porte.
— Tes chaussures, grinça le vieil homme, qui m’attendait de pied ferme dans l’entrée.
— Oui oui, ça vient. Une minute.
— Mauvaise rencontre ?
— Je courrais, simplement, répliquais-je, laconique. Je n’avais qu’une idée en tête, monter à l’étage et retrouver la douce étreinte d’un lit bien chaud. Le confort moderne d’une vie paisible.
Le lendemain matin, je ne sais pour quelle raison, j’acceptais de me prêter à l’exercice du petit déjeuner. On me conduisit ainsi à deux lots de couverts assortis. Une abondance de croissants et de pains au chocolat, des crêpes, des beignets, des confitures, du fromage, et même une assiette garnie de charcuterie brillaient sous le soleil naissant. Située sur la façade Est de la maison, la terrasse donnait sur le verger. Une large section boisée se profilait à l’horizon, dissimulant en partie l’enceinte.
Le vieil homme me demanda si je préférais un café moulu, du thé sucré ou un jus d’orange pressé. Il me présenta un genre de soupe de tomate épicée, et je déclarais d’un air méprisant que mon entreprise n’avait souscrit à aucun supplément.
— On ne fait pas d’extra, me soutint mon hôte d’un ton sans réplique. Ici, c’est tout ou rien. Mange.
Il ne fallait pas me le dire deux fois. J’acceptais la soupe et me réservais une belle portion de charcuterie. Je commandais un café brûlant. Le vieil homme contourna la table et s’installa en face de moi. Nous déjeunions en silence jusqu’à l’arrivée d’Amir, lequel nous rejoignit dehors les cheveux noués en catogan, un tablier serré autour de la taille. Il me servit ce que je lui demandais. Comme je le remerciais du bout des lèvres, il m’adressa un hochement de tête, puis se retira en vitesse, fredonnant un air de sa connaissance. Cet homme me mettait mal à l’aise. Il se dégageait de sa personne une atmosphère étrange, insondable. En outre, je suspectais chez lui un léger retard mental.
Il revint par deux fois de son pas rapide et empesé, constata sans un mot l’avancée du repas. Le vieil homme me proposa une nouvelle assiette. Je refusais poliment, complimentais le chef pour sa cuisine. Ma remarque sembla le satisfaire, car il me gratifia d’un grand sourire. À ce moment, ma fourchette me glissa des doigts. Je manquais de peu d’avaler de travers. Un couple de chevreuil se tenait à une vingtaine de mètres de la table, leurs petits sur les talons.
— Ce n’était pas une plaisanterie hier au soir, tu sais, intervint le vieil homme d’une voix posée. C’est la saison des visites.
Sous la surveillance du mâle, la mère opéra un rapide tour du verger, puis concentra son attention sur un arbre fruitier dont elle partagea les bienfaits avec sa progéniture. Amir reparut alors, vêtu d’une djellaba. Il déposa sur le sol son arrosoir, s’approcha du cheptel. Il se porta bientôt au contact de la mère et lui flatta l’encolure comme s’il s’agissait d’un animal apprivoisé. Le mâle, lui, ne bougeait pas.
— C’est… c’est très dangereux, balbutiai-je.
— Ceux-là viennent tous les ans. Ils nous connaissent.
— Vous voulez dire que vous pouvez les toucher, vous aussi ?
— Non. Il n’y a qu’Amir pour tenter une chose pareille. Il n’existe pas deux hommes sur terre bénie de tels talents.
À présent, le couple s’en retournait à l’intérieur du bois. Amir avait vidé son arrosoir. Il s’attaquait à la coupe des rosiers.
— Il a tout fait tout seul, tu sais, poursuivit mon interlocuteur. Un vieux corps de ferme dont personne ne voulait. Des trous de la taille d’une balle de golf, une herbe aussi haute que des broussailles. Il a commencé par réparer la toiture et débouché les gouttières. Il a remplacé une à une les fenêtres, refait la décoration. Il a recreusé les caniveaux, installé un récupérateur d’eau de pluie. Il a défriché la parcelle, dégagé le jardin, planté des arbres. Il a abattu à l’aide d’une masse une partie du mur d’enceinte, de façon à ce que les bêtes puissent entrer. Personne ne l’a pris au sérieux lorsqu’il a décidé de bâtir cet endroit.
« Sacré projet, en effet », prononçais-je, mon attention portée sur les animaux. J’ignorais pourquoi il me racontait tout ça.
— Personne ne croyait à ce foutu projet. Surtout pas moi, reprit-il sans tenir compte de mes paroles. Je suis arrivé ici sur le tard, car cet imbécile n’avait pas prévu les bons papiers. C’est moi qui me suis chargé de contacter la mairie pour le tout-à-l’égout, moi qui me suis farci le déplacement à la chambre de commerce. La paperasse, ce n’est pas son truc. Il n’est pas câblé pour ça, tu comprends. Il n’a jamais su garder un emploi très longtemps. Mais ça, cette maison, c’était important pour lui. À la signature de l’acte, même le vendeur était perplexe. Tu sais ce qu’il lui a répondu ? « On a qu’une vie. Une seule. On ne nous en donnera pas d’autres. Alors, autant la gâcher. »
Nous reprîmes nos places après une halte devant la machine à café. Après une rapide introduction, le formateur nous présenta la fabrique de « persona », personnages fictionnels basés sur l’ouvrier type rencontré en usine. Le programme générait à la demande un flux sans fin de profils plus vrai que nature. Photographie, personnalité, tranche d’âge, situation familiale, niveau d’études, sans oublier bien sûr le sacro-saint « score de compatibilité » si cher à nos dirigeants. Sous ce terme ô combien nébuleux se cachait une logique froide et calculatrice, une moyenne regroupant selon un obscur algorithme la tolérance du sujet à l’autorité, à la contradiction, sa capacité à court-circuiter la hiérarchie ou son appartenance à un syndicat. Aujourd’hui, toutes les grandes sociétés utilisent ces modèles. Gardez ça à l’esprit lors de vos entretiens, messieurs-dames, la première caractéristique recherchée en entreprise est la docilité.
La veille, nous avions abordé l’installation du logiciel et ses modules, ce mardi, nous nous retrouvions à la tête d’un véritable laboratoire d’expérimentation. Le formateur ne ménageait pas ses efforts, et sous prétexte d’un public exclusivement masculin, ponctuait chacune de ses interventions d’un commentaire sur le physique des « candidates ». Avachi sur ma chaise, je m’occupais à relever la moindre de ses mimiques, je croyais discerner derrière son sourire une profonde lassitude. Un désir soudain de claquer la porte et de nous laisser en plan. Ou peut-être s’agissait-il du reflet de mes propres pensées.
Le travail a toujours pris une place importante dans ma vie. En bon salarié, je ne comptais pas mes heures et veillais tard au bureau. Je m’absentais souvent les week-ends, et lorsque mes missions s’étendaient sur plusieurs années, nous déménagions et mes filles devaient changer d’école. J’ai souvenir ainsi d’un différend auprès d’un contremaître nantais, lequel se bornait à refuser les congés de ses ouvriers, de peur de ne pas respecter les délais imposés par sa direction. J’ai souvenir de ma première retenue sur salaire, infligée à un pauvre gaillard blessé à la jambe dans une usine de conserve bretonne, de l’immense lucidité d’un travailleur lyonnais déclarant des heures inférieures à son temps de production car il préférait bosser gratuitement plutôt que de perdre son emploi. Ma carrière est jalonnée d’injustices, de déjeuners d’affaires et de primes mirobolantes. Le système connaît le prix de tout, c’est pourquoi ses bourreaux sont si bien payés.
De retour de la formation, je repérais un petit télescope installé au milieu du jardin. Il était posé là, sans surveillance. Comme une invitation. Amir et le vieil homme m’attendaient pour dîner. Cette fois j’avais décidé de leur faire l’honneur de ma présence.
On me proposa une viande de mouton légèrement relevée accompagnée de céréales et de carottes en sauce, un repas copieux et succulent. Mes hôtes, toutefois, furent de piètre compagnie. Toujours au service, Amir ne prononça pas un mot de la soirée, et je le surpris à m’épier à de nombreuses reprises. Le vieil homme quant à lui ne cessait d’être indiscret. Il souhaitait connaître les détails de ma scolarité, m’interrogeait sur mes rêves d’enfants, ou sur mon couple, avant d’observer un long silence solennel. Il s’adressait à moi d’un ton monocorde, empreint d’une familiarité déplacée. Comme si nous appartenions à la même famille. Ses continuels assauts me portaient sur les nerfs, et lorsqu’il s’enquit du contenu de ma formation, je lui livrais un témoignage brutal et sans filtre. Il me dévisagea alors de derrière ses lunettes rondes, puis me demanda s’il me convenait de traiter mes semblables de cette façon. Je manquais m’étouffer, lui crachais à la figure que je n’acceptais guère que l’on m’insulte de la sorte.
— Vous n’êtes pas votre travail, asséna-t-il d’une voix posée, avant de me proposer un thé chaud.
À ceci, je quittais la table et lui répliquais qu’il serait de bon ton à l’avenir de revoir l’accueil des clients, que s’il ne souhaitait pas mettre la clef sous la porte, il pourrait commencer par ajouter des prises de courant dans les chambres. Par sa faute, j’étais forcé de consulter mes mails pendant la pause du midi et accumulais malgré tout un retard conséquent. Pour toute réponse, il se contenta de hausser les épaules.
Je sortais fumer. Je n’avais rien de mieux à faire de toute façon.
Au troisième jour de formation, le blanc-bec aux oreilles décollées décida de nous mettre à l’épreuve. Nous nous rassemblâmes par groupe de trois et chacun endossa à tour de rôle le costume de l’ouvrier, du manager ou du responsable de direction. Les cas traités nous étaient proposés via une présentation PowerPoint, les acteurs tirés de la banque de données des « persona ».
Le premier groupe gérait un violent accrochage entre deux manutentionnaires d’une boîte d’expédition, le second le retour d’un graphiste après un arrêt maladie prolongé. Les scènes étaient grossières, les fous rires nombreux. Mal à l’aise, les collègues n’hésitaient pas à forcer sur la caricature. Le but de l’exercice était d’aborder la situation avec calme et pragmatisme, puis de mettre à jour les fichiers du logiciel.
À mon tour, je me retrouvais campé derrière mon bureau, feignant tapoter les touches de mon ordinateur face à un ouvrier peu scrupuleux accusé d’avoir falsifié en douce le contenu de ses rapports quotidiens. Je le recevais d’une solide poignée de main, l’encourageais en douceur à reconnaître la qualité des services de l’entreprise, puis pointais ses errances, déclarant que l’honnêteté était la pierre angulaire d’une équipe soudée sur la chaîne de production.
Le blanc-bec salua ma prestation de vifs applaudissements, rattacha la finesse de mon propos à mes années sur le terrain. Il n’avait pas tout à fait tort. J’ai traité au cours de ma carrière des centaines de dossiers. Je connais les ficelles du métier, à commencer par sa première règle cardinale : la vérité n’a aucune importance. Lorsque votre travail consiste à licencier, à infliger des sanctions ou à justifier l’invraisemblable, vous vous découvrez une troublante proximité avec la langue de bois. Et si par morale ou par ignorance vous refusez de vous adapter, vos supérieurs se chargeront de vous ramener à la raison. J’en ai fait moi-même les frais en début de carrière.
Ma première mission eut lieu près de la banlieue parisienne. J’avais travaillé dur et figurais parmi les lauréats de ma promotion. J’étais animé par une réelle volonté de justice, celle d’apporter à qui travaillerait sous mes ordres un véritable confort de vie. J’étais décidé à réformer le système de l’intérieur. J’avais rejoint les rangs d’une petite boîte d’intérim où l’on m’avait dirigé d’emblée sur un poste de coordinateur dans une usine de pièces détachées, l’occasion pour moi de me jeter à l’eau, de prouver ma valeur au reste du monde. Seul bémol, je connaissais peu le domaine automobile. Le recruteur, un quarantenaire à la carrure imposante et au sourire ravageur, m’avait assuré que cela ne posait pas le moindre problème, que je serais bien encadré. Aussi avait-il ajouté qu’il me rendrait visite le jour de ma prise de fonction et que nous parlerions ensemble des modalités de mon contrat. Rien ne se déroula comme prévu.
Chez le client, la réceptionniste m’accueillit d’un air froid. Je fus conduit jusqu’au gestionnaire des ressources humaines, lequel m’annonça d’entrée de jeu qu’il était très heureux de travailler enfin aux côtés d’un homme d’expérience. Lorsque, naïf, je lui signalais qu’il devait faire erreur et lui présentais mon cursus, il m’adressa un regard désespéré, m’ordonna de l’attendre devant la porte de son bureau. Le recruteur apparut en milieu de matinée. Il me salua d’un clin d’œil complice, poussa la porte, puis s’entretint en privé auprès du gestionnaire. Au sortir d’une courte entrevue, il demanda à me voir à part. Je lui expliquais en quelques mots la situation, défendais qu’en l’absence de formation préalable, je ne pourrais pas exercer correctement. Il me gratifia alors d’un grand sourire poli et m’assura de toute sa confiance. J’apprendrais sur le tas, à la vieille école, comme on dit. Je lui opposais d’abord un refus, mais face à son insistance, à ses compliments répétés, je cédais à sa requête, incapable de percer à jour sa stratégie. Nous poursuivîmes la visite en compagnie du gestionnaire, et je compris à ses paroles qu’il avait simplement survendu mes compétences, qu’il comptait sur ma discrétion.
Enfin, sur les coups de midi, nous nous retrouvâmes à la cantine, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je le vis décacheter sa valise et déposer face à moi une pile de papier.
Je signais mon premier contrat de travail sur un coin de table, sans négociations, sans même lire une ligne.
— Bienvenue dans la famille, me lança mon interlocuteur, avant de me servir une rasade d’eau.
Nous trinquâmes tous deux à ma réussite, et malgré le brouhaha ambiant, le tintement du verre se prolongea longtemps dans mes oreilles. Par ce geste anodin, je m’engageais à épouser les codes d’un monde qui n’était pas le mien. Un univers ingrat, cruel, inhospitalier. Je renonçais sans le savoir à une part de moi-même.
Le repas de ce soir-là se déroula sans accroc. Ma réaction de la veille devait les avoir refroidis, car le vieil homme ne m’adressa guère la parole si ce n’est par nécessité. Amir, quant à lui, ne changea rien à son comportement. Je me laissais tenter par un thé brûlant puis, ragaillardi, enfilais de nouveau mes chaussures. Je débutais mon tour par les vergers fleuris, arrachais une poire juteuse que je croquais à pleines dents. Je poussais jusqu’à la lisière du bois, en quête de quelque présence animale. Le hululement d’une chouette m’accueillit, et je remplissais aussitôt mes poumons d’air frais. Le simple chant de cet oiseau m’apaisait. Le jardin, baigné dès la nuit tombée d’une lumière tamisée, m’apparaissait à présent tel un foyer chaleureux. Par un heureux hasard de circonstance, je rencontrais Amir sur ma route. Un sac à dos sanglé sur les épaules, il s’éclairait à l’aide de son bougeoir et transportait de la main gauche un genre de bidon jaune orangé. Il ne semblait pas m’avoir remarqué.
Avide de tirer au clair les raisons de ses mystérieuses sorties nocturnes, je décidais de le suivre.
Le pourtour de sa djellaba voletait à mesure de ses foulées rapides. Il me distança en peu de temps, mais la lueur de son instrument me renseignait sur sa position. Au bout d’une minute à peine, cette dernière se stoppa net, et je le surpris accroupi au milieu de nulle part, sondant les ténèbres à l’aide de sa bougie. La lumière caressait ses traits, et je perçus à son expression une gravité que je ne lui connaissais pas.
Au terme d’un minutieux examen, il s’empara d’un petit boîtier posé à même le sol, rapprocha le bidon jaune orangé, défit les lanières de son sac et se mit au travail. Je le contournais, désireux d’épier la scène sous un meilleur angle. Je découvris ainsi l’objet de ma curiosité, une vulgaire lampe à pétrole, et réalisais soudain l’ampleur de la tâche accomplie. Cet homme ravivait de ses seules mains tous les feux du domaine !
Fort de cette révélation, je me surpris bientôt à suivre en détail son cheminement. Le ciel et la terre se confondaient en une immense tapisserie étoilée, et il m’arrivait de perdre sa trace. Je scrutais alors l’horizon à la recherche de nouvelles naissances, en déduisais le va-et-vient de l’auréole de son bougeoir. Je m’étonnais de son inépuisable vivacité, de son sens de l’organisation. Son parcours était tout à fait étudié. Il le ramenait immanquablement à hauteur du garage, dont il resurgissait aussi sec, animé d’une énergie renouvelée. Sans doute se ravitaillait-il en combustible. Ma filature se prolongea jusque tard dans la nuit, et j’abandonnais mon hôte en pleine besogne. À croire qu’il était insensible à la fatigue.
Je quittais le verger, longeais la façade principale. Je m’apprêtais à franchir le seuil lorsque mon regard se porta en direction du jardin. Aussitôt, j’empruntais le chemin empierré, dépassais l’arche végétale.
Le télescope était toujours là, pointé vers le firmament. Un jeu de lanternes éclairait le gazon tout autour, formant les branches d’une étoile. Le tout rappelait à s’y méprendre la croix juchée au sommet de la porte d’entrée, près du portail et au-dessus de mon lit.
Je jetais un coup d’œil aux alentours et, persuadé à tort de ma solitude, contournais le symbole lumineux, mon attention fixée sur l’angle tracé par la lunette. Elle était mal positionnée…
Le lendemain, au cours du déjeuner, j’interrogeais le vieil homme à ce sujet, et celui-ci s’irrita de ce qu’il considérait comme la dernière lubie en date de son compagnon. Amir se passionnait pour tout, mais sans jamais pousser très loin son initiation. Il alla même jusqu’à me proposer le télescope. Amir me servit une nouvelle tasse de café, et je profitais de son absence pour aborder la nature de ses activités nocturnes.
— En ce moment, comme la nuit tombe tôt, il doit s’interrompre pour cuisiner. Une vraie pagaille, se contenta de râler le vieil homme.
— Parce qu’il sort souvent, comme ça ?
— Toute l’année. Et encore, il s’est assagi avec le temps. Au début, il ajoutait même des rondes, juste au cas où.
— Mais pourquoi il s’impose un truc pareil ? C’est un genre de croyance ? Pour guider les âmes des morts ou quelque chose comme ça ?
— Il fait ça pour vous. Comme tout le reste.
Je ne relevais pas. À ce stade, je commençais à connaître la chanson.
— Il y a une paire d’années, une fillette s’est perdue en forêt, reprit mon interlocuteur. « Ses parents se sont disputés, je crois. En tout cas, ils se sont éloignés et ont égaré la gamine. La petite a eu les bons réflexes et s’est rapidement cachée. À la nuit tombée, elle s’est dirigée par ici. Elle avait aperçu une lumière au loin, celle de la chambre que tu occupes en ce moment. Amir l’a trouvée et ramenée à l’intérieur. Il a décidé de tout éclairer après cet incident. »
— En tant que parent, je peux comprendre sa réaction. Mais de là à rejouer la scène toute l’année… Il est jeune, mais quand même.
— Jeune ? C’est l’aîné de la famille. Il a presque soixante-dix ans.
— Vous vous moquez de moi ?
— Puisque je te le dis. Après, tu peux toujours le lui demander. Il te répondra peut-être, ajouta-t-il, une lueur de malice dans les yeux.
Je ne poussais pas plus loin la conversation. Mon café terminé, je remontais jusqu’à ma chambre, le temps de préparer mes affaires. À mon départ, je rencontrais Amir sur l’aire de stationnement. Le gravier crissait sous nos pas, et je remarquais une légère pointe de gris sous ses longs cheveux châtains. Son visage n’en était pas moins rieur et juvénile. Je repensais au contact de ses doigts calleux, lequel me rappelait celui de nombreux artisans sur le point de partir en retraite. Cette sensation de parcourir l’écorce d’un arbre. Je m’aperçus qu’à l’exception de notre première rencontre, il portait toujours des gants.
Jamais je n’ai osé l’interroger sur son âge.
Ce jeudi, nous apportâmes une touche finale à notre initiation. En milieu d’après-midi, le formateur nous déclara fin prêts pour nous frotter à l’examen, et nous passâmes la dernière heure de la journée à relater nos expériences respectives. La conversation allait bon train. Chacun suivait ou commentait le récit en cours d’un feint enthousiasme, impatient d’obtenir la parole à son tour.
Mon absence de participation dut paraître insoutenable, car le blanc-bec m’encouragea soudain à ajouter ma pierre à l’édifice. Je refusais d’abord, mais face à l’indignation et aux plaisanteries douteuses, je décidais de céder aux exigences de mon public. Je ne sais pourquoi, mes lèvres se figèrent toutefois, l’oxygène semblait avoir déserté mes poumons.
Le formateur crut bon de me faire remarquer que je ne pouvais plus reculer à présent et c’est tout naturellement que j’exhumais devant l’assistance le pire incident de toute ma carrière.
Il s’agissait d’un développeur informatique. Un employé de longue date, brillant, passionné, reconnu pour son travail. Un homme qui aurait pu être mon père, et dont j’ai concouru à la destruction. Fraîchement débarqué dans les locaux de l’entreprise, j’étais pour ainsi dire incapable de comprendre ce qu’il faisait. Des lignes et des lignes s’entassaient sur le terminal de son ordinateur, et celui-ci accomplissait comme par magie tout ce qu’on lui demandait. Ce n’était pas à lui pourtant, mais à moi qu’on avait confié la charge du projet. Après de rudes négociations, le pôle marketing avait promis au client que la commande serait prête au plus tard d’ici deux mois, et l’homme, en ouvrier consciencieux, s’était empressé de tirer la sonnette d’alarme. Selon lui, il s’agissait d’un pari impossible. Proposer une solution fiable sur un tel délai nécessitait une équipe solide, non pas un unique technicien, aussi dévoué soit-il. En bon communicant, je veillais moi-même à museler son opinion, le rassurant sur ses capacités. Personne ne s’intéressa à son diagnostic, et lorsque la livraison eut lieu, les plaintes répétées du client ne tardèrent pas à alerter la direction. Mes supérieurs se retournèrent contre moi, et j’eus tôt fait de reporter la responsabilité de ce fiasco sur mon subordonné. Je confiais le projet à quelqu’un d’autre, lui infligeait un blâme, puis le conviait à suivre une formation « qualité » afin de combler ses lacunes. Il refusa d’y assister, et son entêtement à incriminer la hiérarchie, à remettre en cause mon autorité motiva bientôt la décision de se séparer de lui. Il était hors de question pourtant de le licencier, car son ancienneté aurait coûté cher à l’entreprise. J’avais déjà vécu de pareilles situations, et lorsque les pontes de la société s’accordèrent à le pousser vers la sortie, je me faisais le premier instrument de leur volonté. Je m’arrangeais sans cesse à faire déplacer son bureau, lui imposais les tâches les plus rébarbatives ou le laissais sans rien faire durant des semaines. L’homme, toutefois, était un dur à cuire. Il encaissait d’un simple hochement de tête chacune de mes offensives, s’acquittait de son travail sans broncher. Il refusait d’adresser la parole à qui que ce soit. La mention de son premier arrêt maladie fut célébrée en hauts lieux. Il avait contracté un cancer fulgurant, lequel, je l’appris plus tard, l’emporta en l’espace de quelques mois. La société, bien sûr, s’était dédouanée de tout mauvais traitements. Le directeur était même allé jusqu’à présenter en personne ses condoléances à la famille. Aucune action en justice n’a jamais été entreprise. Mais la vérité persiste. Nous l’avons tué et nous nous en sommes félicités. Quant à moi, j’avais veillé à noyer toute cette affaire sous une chape de béton.
Mon histoire terminée, j’ai croisé les bras sur ma poitrine, sans laisser paraître la moindre émotion. Le formateur se déclara attristé du dénouement, puis insinua que j’avais peut-être mal interprété certaines choses, que le drame m’avait manifestement perturbé. Je lui assurais qu’il avait sans doute raison. Mes chers collègues semblaient à court de pitreries, plusieurs d’entre-eux me fuirent du regard jusqu’à mon départ.
J’ai roulé ce soir-là aussi vite, aussi dangereusement que possible. Je me souviens avoir manqué percuter un cerf près de la forêt. Je me souviens du crissement des pneus lorsque j’ai tiré le frein à main devant la maison.
Un silence pesant présida à la tablée. Aux habituels sourires d’Amir, je répondais par de profonds soupirs, haussais les épaules, ou lui présentais un rictus exagéré. Je touchais à peine à mon assiette, refusais café et pâtisseries. Sur le point de quitter la table du dîner, je rencontrais le visage désabusé du vieil homme.
— Tu n’as pas retiré tes chaussures.
— Pas envie.
— Retire tes chaussures. C’est la règle, ici.
— Vous commencez à me gonfler avec vos règles à la con.
Devant le souffle exaspéré du vieil homme, devant le fredonnement d’Amir, occupé à débarrasser les couverts, je me souviens être entré dans une colère noire. Tout y est passé, du confort spartiate de la maison à l’accueil qui me fut réservé le jour de mon arrivée. Je reprochais au vieil homme son ton maussade, ses remarques acerbes et cyniques, ses exigences insupportables. Mais ce n’était rien en comparaison de ce que je crachais au visage d’Amir.
Je raillais son mutisme, ses chants infantiles, sa perversion. Je le pointais du doigt et déclarais avoir compris son manège : il était partout et nulle part à la fois, toujours aux premières loges pour observer les clients. Car c’était bien ce dont il s’agissait. Il avait racheté puis retapé cette maison, cet enclos sordide dressé à l’écart du monde. Il appâtait les voyageurs par ses tarifs bon marché et son cadre de vie, les assommait par des règles idiotes et les laissait mijoter à petit feu. D’où la méfiance des gens du coin. L’histoire de la petite fille était fausse. Les lanternes permettaient à Amir de mieux repérer ses victimes. Je refrénais un frisson au souvenir de l’étrange symbole composé autour du télescope. Le vieil homme qualifia mes propos de tissu d’âneries, j’écrasais mon poing sur la table, lui ordonnais de la fermer. Je menaçais de quitter les lieux sur le champ. À ce moment, Amir cessa de chanter. Il s’essuya les mains sur son tablier, se présenta face à moi. Je lui interdisais d’approcher, lui demandais s’il prenait plaisir à me regarder tourner dehors tel un lion en cage. Je tentais par tous les moyens de le faire sortir de ses gonds.
Pour toute réponse, il s’avança vers moi, chercha à poser une main sur mon épaule. Je le repoussais presque aussitôt, me jetais sur lui, prêt à frapper. Il ne bougea pas d’un cil, et je crus percevoir au fond de son regard une étrange lueur dorée, à la fois sinistre et réconfortante.
Je reculais d’un pas, prononçais d’une voix sourde que je bouclais mes valises sur le champ, que d’une manière ou d’une autre le pare-chocs de ma voiture franchirait le portail d’entrée.
Je n’empruntais pas pourtant le grand escalier, mais me réfugiais dehors, au milieu du jardin, où je me précipitais sur mon briquet et mes cigarettes. Mon empressement me porta au contact d’une masse sombre que je percutai de tout mon poids.
Je redressais le télescope avec précaution, étendais les bras du trépied, de sorte à obtenir une assise confortable. Je réorientais la lunette selon mes maigres connaissances. Je m’écartais enfin, ramassais mon briquet, le souffle coupé, une cigarette au coin des lèvres.
La Lune, pâle et gibbeuse, m’apparut alors dans toute sa splendeur.
Aujourd’hui encore, je ne sais pas ce qui m’a pris. Après un rapide coup d’œil en direction de la maison, j’entrepris de pointer l’appareil vers la lune. Je rencontrais des difficultés à manipuler le dispositif, et je dois bien admettre que mes premières observations produisirent des résultats mitigés. À travers la lunette, je découvrais tantôt un fond noir opaque, tantôt le détail des tuiles du garage ou des pierres du mur d’enceinte. Je déduisis de l’examen approfondi du sommet d’un sapin que la lentille renvoyait une vision renversée de la réalité. J’ajustais alors mes calculs.
J’étais animé d’une énergie nouvelle, irrépressible. Mes membres s’activaient d’eux-mêmes. Je déployais et redéployais sans cesse les pieds du télescope, manœuvrais ses rouages, modifiais l’angle du tube optique. Passant une main sur mon visage, je pris conscience que ma cigarette était froide. Elle n’avait jamais touché la flamme de mon briquet. Je replaçais celle-ci à l’intérieur de son paquet, poursuivis mon œuvre sans tarder.
Lorsqu’enfin, je pensais obtenir le résultat escompté, je ne décelais toujours aucune trace du sol lunaire. La présence toutefois d’une petite tache sombre au milieu du réticule éveilla ma curiosité.
Je constatais la propreté de la lunette, jouais sur la netteté du rendu. Je dus vérifier par deux fois la nature du sujet avant de bien saisir l’ampleur de ma découverte. Cette couleur ambrée, ces anneaux reconnaissables entre mille. L’image en elle-même dépassait à peine la taille d’une pièce de deux euros. Ce que je voyais pourtant n’était autre que la géante gazeuse Saturne, l’un des plus grands corps célestes du système solaire. Il ne s’agissait pas d’un vulgaire cliché obtenu après une rapide recherche internet, mais d’une observation en temps réel. Moi, simple mortel, poussière d’étoile échouée au fin fond du sud de la France, je me trouvais en présence d’un titan.
J’ai passé de longues minutes l’œil pressé sur l’objectif, m’abîmant à distinguer ses courbes, opérant par gestes minutieux, de peur de déplacer le trépied de ne serait-ce qu’un millimètre. Le mouvement du ciel finit néanmoins par me ravir Saturne. Elle glissa en dehors de mon champ de vision sans que je n’y comprenne quoi que ce soit, mes vaines tentatives de recalibrage ne faisant qu’accentuer ma confusion. À la perte de ce trésor, je me surpris toutefois à n’éprouver aucun regret. Une soif de curiosité, plutôt. La sensation de toucher du doigt un territoire infini. L’air était doux, le temps dégagé. Si Saturne m’était accessible, le reste du cosmos l’était tout autant.
De cette nuit-là, je garde un souvenir précis, empreint d’une forte émotion. Il me suffit de fermer les yeux pour percevoir de nouveau le ruissellement continu de la fontaine, de sentir le contact râpeux de l’herbe grasse sur mon cou lorsque, étendu sur le gazon, je contemplais les étoiles, les deux mains pressées derrière la nuque, à la recherche du plus petit point d’intérêt. J’ai retrouvé Saturne une fois posté à l’autre bout du jardin, le télescope planté sous l’arche végétale. J’ai ratissé en vain le ciel profond, ignorant que je ne disposais pas du matériel requis. Je me suis félicité devant ce que j’ai longtemps cru être Vénus, une découverte impossible selon les cartes de ce soir-là. J’ai parcouru la surface de la Lune et visité ses nombreux cratères. Le temps s’est arrêté pour moi.
Le lendemain, je ne me suis pas présenté à la formation. Je me suis réveillé en milieu de matinée, allongé près du télescope. Amir arrosait les rosiers, chantonnant un air à sa façon.
Je trouvais le vieil homme à son bureau, et sa première réaction fut de me proposer de déjeuner. Nous nous retrouvâmes sur la terrasse, où je compris bientôt qu’il n’avait pas mangé. Sans doute s’était-il aperçu au petit matin de la présence de ma voiture et en avait déduit que j’avais changé d’avis. Ni la formation ni mes propos de la veille ne furent évoqués au cours du repas. Amir me servit mon café comme si de rien n’était. Le vieil homme avalait sa soupe sans un mot. Lorsqu’il déclara qu’il ne pensait pas me revoir de sitôt, je sautais sur l’occasion et lui demandais s’il était possible de rester une nuit supplémentaire. Il me répondit après un court silence qu’une fois encore, je n’avais pas écouté les consignes.
Toute réservation au « Clos » s’étendait sur une semaine. Quelle que soit la durée du séjour, la chambre était louée jusqu’au bout.
Au bout du compte, je libérais les lieux dimanche en fin de matinée. Sur le départ, Amir me gratifia d’un beau sourire. Nous échangeâmes une solide poignée de main, puis il disparut en cuisine, où l’attendait la vaisselle du petit déjeuner. Le vieil homme, quant à lui, me remit un fascicule, une enquête de satisfaction que je dus remplir sur le champ. Lui seul m’accompagna sur l’aire de stationnement. Il m’invita à conduire prudemment, me regarda charger une à une mes valises. À peine eus-je le temps de claquer le coffre de ma voiture qu’il s’en retournait déjà jusqu’à la maison, sans même me dire au revoir.
Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, je n’ai pas quitté mon poste après mon séjour au « Clos ». Le retard accumulé sur mes dossiers et mon absence injustifiée à la formation me valurent les foudres de mon supérieur, lequel ne manqua pas de me saquer au cours de mon entretien annuel. Il m’a fallu encore cinq ans avant de décider de réduire mes heures, puis j’ai claqué la porte et repris des études presque du jour au lendemain. À mon âge, la transition n’a pas été facile. J’y ai perdu des amis, des relations. Mon confort de vie en a pris un coup et mon couple de l’époque a volé en éclat. Le divorce n’a toujours pas été prononcé. Je vois mes filles une semaine sur deux, un accord tacite avec mon ex-femme. Mais je ne regrette rien. Tout changement a un prix, et je ne voudrais pour rien au monde revenir en arrière.
Aujourd’hui, à la veille d’un examen qui pourrait changer ma vie, je repense à ce vieux corps de ferme et à ses deux occupants, à cette nuit passée seul à observer les étoiles, à me recentrer sur l’essentiel.
L’absence d’électricité, les frasques du vieil homme, le mutisme d’Amir, ses regards appuyés, malgré toutes les étrangetés liées à cette fameuse semaine, la présence du télescope revêt pour moi encore à ce jour du plus grand mystère.
Jamais je n’avais évoqué auprès de qui que ce soit mon attrait pour l’espace. Pire, j’avais moi-même oublié jusqu’à son existence, une passion dévorante née au travail, puis ensevelie sous le poids des années. De toutes les expériences vécues au cours de ma carrière, il en est une qui m’a profondément marqué. Un remplacement en Île-de-France dans une entreprise publique d’aéronautique. Le responsable attitré s’était brisé le col du fémur après une chute en parapente.
Dès les premiers jours de ma prise de fonction, je fus surpris de rencontrer des gens aussi enthousiastes. Une équipe soudée, brillante, portée sur un unique objectif : celui de faire avancer la découverte scientifique. Je ne prétends pas ici que l’ambiance était idyllique. Tout projet d’envergure recèle ses faiblesses, et il subsistait toujours des tensions avec la direction, notamment en ce qui concernait l’octroi de subventions de l’État, en berne depuis de nombreuses années. L’entreprise s’affairait à la conception d’outils à destination d’une sonde spatiale. Un travail minutieux, difficile, car les composants ne devaient jamais profiter d’aucune maintenance une fois le lancement effectué. Personne à mon arrivée ne doutait de mon inexpérience, et j’imagine que la ferveur ambiante et mon ouverture d’esprit participèrent à mon intégration. Chaque jour ou presque, je bénéficiais de cours magistraux donnés par des cerveaux brillants. Ici en termes d’alliages, de matériaux, là au sujet de la cartographie céleste, du mouvement des planètes ou de la physique élémentaire. J’appris à titre d’exemple que les ordinateurs de bord dont on équipait les satellites étaient en réalité très sommaires, loin des toiles de complexité vantées au cinéma, ou qu’une sonde, peu de temps après son départ, était plongée dans un profond coma pendant de longues années, de sorte à économiser la plus petite quantité d’énergie. Au-delà de leurs domaines d’expertise, les hommes et femmes dont j’avais la charge étaient dotés d’un mental d’acier doublé d’un parfait détachement. Soumis aux contraintes du vide spatial, aux distances démesurées du cosmos, l’exécution d’un forage ou d’un simple prélèvement d’analyses demandaient plusieurs dizaines d’années de développement, et ce sans l’assurance du moindre résultat. Véritable leçon de dévouement et d’humilité.
Aujourd’hui, je repense à ces quelques mois passés en autarcie, aux larmes roulant sur mes joues lors du retour du parapentiste.
À mon arrivée au « Clos », j’avais découvert une terre illuminée de mille feux. Amir veillait chaque nuit à en éclairer le moindre recoin. Au soir pourtant de ma première observation, il était resté bien sagement à l’intérieur. Pas une lanterne ne brillait lorsque j’ai quitté ma voiture et omis de retirer mes chaussures. Pas une lanterne ne guidait mes pas lorsque, incapable de poser un pied devant l’autre, j’ai percuté le télescope et amorcé mon lâcher-prise.
Il en fut de même jusqu’à mon départ.